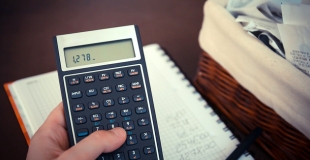Mon conjoint peut-il m’aider dans l'entreprise ? Quel statut ?

Le conjoint d’un chef d’entreprise dans le domaine artisanal, industriel, commercial ou libéral peut participer à l’activité de la société très ponctuellement. En revanche, si le conjoint, marié, pacsé et dans certains cas vivant en concubinage, aide et participe de manière régulière à la vie de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il exerce une activité professionnelle fréquente au sein de l’entreprise, il doit déclarer un statut spécifique par rapport à sa situation. Ce statut lui donne des droits, mais aussi des obligations, en matière professionnelle et en ce qui concerne ses droits sociaux.
Pourquoi un statut pour les conjoints ?
Le choix d’un statut pour un conjoint qui exerce une activité professionnelle régulière et habituelle dans l’entreprise de son partenaire est obligatoire. Le critère de participation à la vie de l’entreprise n’est pas apprécié par rapport au temps passé au sein de la société mais en fonction de son implication régulière. S’il exerce une activité non salariée ou une activité au sein d'une autre entreprise au moins à temps partiel, il est présumé ne pas exercer régulièrement au sein de l'entreprise de son époux(se) ou partenaire de Pacs.
Pour le conjoint, ce statut lui confère des droits et des devoirs en matière professionnelle et sociale. Dans le cas d’une création d’entreprise, ce statut doit être choisi et déclaré au moment de son immatriculation. À noter, qu’il est possible de changer de statut à tout moment ensuite.
Les différents statuts possibles pour un conjoint dont l’activité est régulière dans l’entreprise
Le conjoint collaborateur
Le statut de « conjoint collaborateur » s’adresse à l’époux ou au partenaire pacsé (mais pas à la personne qui vit en concubinage) d’un entrepreneur individuel qu’il soit commerçant, artisan, profession libérale ou encore micro-entrepreneur ; d’un gérant associé unique d’une EURL ou d’un gérant associé majoritaire d’une SARL. Jusqu’à maintenant, un seuil de 20 salariés maximum présents dans l’entreprise était requis pour pouvoir bénéficier du statut de « conjoint collaborateur ». Toutefois, la loi Pacte de mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a supprimé ce seuil qui disparaîtra à partir du 1er janvier 2020.
Le statut de « conjoint collaborateur » permet d’acquérir un rôle de mandataire au sein de l’entreprise. Il peut ainsi accomplir des actes d’administration et de gestion courante, mais sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. Pour bénéficier de ce statut, le conjoint collaborateur ne doit pas être rémunéré, ni être associé dans la société.
Le conjoint collaborateur bénéficie de la formation professionnelle et d'une protection sociale. Il doit aussi être affilié à un régime d'assurance vieillesse et dépend de la sécurité sociale des indépendants en ce qui concerne la retraite de base, la retraite complémentaire et l'assurance invalidité-décès.
Dans le cas du conjoint d’un micro-entrepreneur, il peut aussi bénéficier des conditions simplifiées de paiement des cotisations sociales liées à ce régime.
Le statut de « conjoint collaborateur » cesse à sa demande ou automatiquement si le statut de l’entreprise est modifié, au décès du chef d’entreprise ou en cas de divorce ou cessation de Pacs.
Le conjoint associé
Le statut de « conjoint associé » concerne à la fois l’époux, le partenaire de Pacs ou le concubin du chef d’entreprise. Ce dernier doit être à la tête d’une SARL, d’une société en nom collectif (SNC), d’une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ou d’une société par actions simplifiée (SAS).
Pour bénéficier du statut de conjoint associé, ce dernier doit détenir des parts sociales dans l’entreprise, c’est-à-dire effectuer un apport. En conséquence, il détient un droit de vote lors des assemblées générales de la société et, comme tout associé, sa responsabilité est limitée à son apport. Il peut également bénéficier du versement de dividendes et il est soumis à l’impôt sur les sociétés. Le conjoint associé peut être cogérant de la société. Ainsi, en cas de faute, sa responsabilité peut être engagée à hauteur de son patrimoine personnel. Le conjoint associé peut aussi être salarié de l’entreprise.
La déclaration du statut de conjoint associé doit être indiquée au moment de la création de l’entreprise. Ou, si elle intervient plus tard, elle doit être déclarée dans les 2 mois qui suivent le début de sa participation professionnelle régulière dans la société.
D’un point de vue social, deux cas de figure existent :
- si le conjoint associé est à la fois gérant minoritaire ou égalitaire, ou salarié de l'entreprise, il est affilié au régime de la sécurité sociale ;
- s’il est à la fois gérant majoritaire ou associé non-gérant, ou non salarié travaillant dans l'entreprise, il est rattaché à la caisse de sécurité sociale des indépendants.
Si le conjoint associé cède ses parts sociales, il perd son statut.
Le conjoint salarié
Le statut de « conjoint salarié », tout comme celui de « conjoint associé », s’adresse à l’époux, au partenaire de Pacs ou au concubin d’un entrepreneur individuel, d'un dirigeant de société, d’un gérant associé unique ou d’un gérant associé majoritaire d'une SARL.
Le conjoint salarié signe un contrat de travail (CDD ou CDI) et perçoit un salaire au moins égal au Smic qui peut être déduit du résultat imposable de l’entreprise : en totalité, lorsque les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens ou que le dirigeant a adhéré à un centre de gestion agrée, ou dans la limite du montant annuel du Smic quand les époux sont mariés sous un régime de communauté sans adhésion à un centre de gestion agrée.
En tant que conjoint salarié, le chef d’entreprise est tenu de procéder à une déclaration d’embauche.
L’activité professionnelle du conjoint salarié peut être à temps partiel. Comme tous les salariés, il bénéficie de la formation professionnelle et d’une protection sociale.
Le statut de conjoint salarié cesse en cas de démission, à la fin du contrat de travail s’il s’agit d’un CDD ou en cas de licenciement.
Dossiers similaires
-
SARL : comment gérer l'assemblée générale annuelle ? Une Société à responsabilité limitée (SARL) est l'une des formes juridiques que peut prendre une société. Il s'agit du statut le plus utilisé par les entrepreneurs français quelle que soit...
-
Transmettre son entreprise : comment s'y préparer ? Nos conseils Vous êtes un chef d’entreprise et vous prévoyez de transmettre celle-ci dans un futur plus ou moins proche. Avant de vous lancer, sachez que cette opération nécessite la réalisation de...
-
Qu'est-ce que le nantissement de fonds de commerce ? Le nantissement de fonds de commerce est une sorte de garantie qu’un débiteur peut apporter à son créancier. En effet, l’opération consiste à mettre les biens meubles incorporels du fonds de...
-
Qu'est-ce que la CVAE ? Comment la calculer ? La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est une contribution due par les entreprises et les travailleurs indépendants aux collectivités territoriales telles que les communes,...
-
Comment fonctionne la distribution des dividendes ? Quelles limites, quelles règles ? On appelle dividende la partie des bénéfices d’une société qui peut être distribuée, selon la forme juridique de cette dernière, aux associés, aux actionnaires et aux dirigeants (personnes...
-
Faut-il louer ou acheter les bureaux de son entreprise ? Parmi les décisions que doit prendre un chef d’entreprise, définir la localisation et la surface de ses bureaux professionnels est déjà très important. Savoir s’il doit acheter ses locaux ou...
-
Part de marché : définition, comment l'estimer pour son entreprise ? La part de marché est un bon moyen pour une entreprise de se positionner sur le marché de son secteur d’activité par rapport à ses concurrents. Elle peut être calculée en tenant compte du...
-
Budget prévisionnel : qu'est-ce que c'est ? Comment le construire ? Réaliser un budget prévisionnel quand on est un professionnel, c’est tout simplement créer un outil pour son entreprise : il s’agit d’orienter les fonds disponibles vers les bonnes...
-
Le DAF (Directeur Administratif et Financier) : quelle fonction dans l'entreprise ? Le DAF (Directeur Administratif et Financier), souvent appelé simplement directeur financier, est en lien direct avec le chef d’entreprise (ou l’équipe dirigeante). Il occupe un poste de cadre...
-
E-commerce : quelles obligations légales pour son site de vente en ligne ? Lorsqu’une entreprise fait du e-commerce, elle est soumise à certaines obligations légales que son site de vente en ligne doit comporter. Mentions légales, conditions générales de vente,...
-
La donation-partage d'une entreprise ou comment organiser sa succession de son vivant La donation-partage est un procédé qui permet à un chef d’entreprise de distribuer de son vivant une partie ou la totalité de ses biens à ses héritiers ou à des tiers. Ce dispositif, qui...
-
INPI : quel est le rôle et fonctionnement de cet organisme ? L'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, a pour première mission pour le compte de l'État de protéger la création et l'innovation française, qu'elle soit littéraire ou...