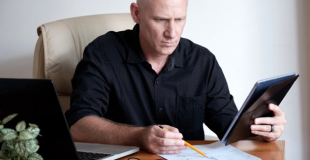La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : explications, calcul, exonération

La Cotisation foncière des entreprises (CFE) désigne l’une des deux taxes qui composent la contribution économique territoriale (CET), avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Elle est due aux communes par les entreprises et les particuliers qui exercent une activité professionnelle non salariée et qui disposent de locaux ou de terrains sur leur territoire.
Quelles sont les entreprises redevables de la CFE ?
La Cotisation foncière des entreprises (CFE) est une taxe collectée au niveau des communes dont sont redevables toutes les entreprises et les personnes physiques, quelque soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d'imposition, qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée au 1er janvier de l'année d'imposition. De fait, même les micro-entrepreneurs doivent payer la CFE.
L’activité professionnelle doit présenter un caractère habituel, être exercée à titre professionnel et être non salariée.
En revanche, les entreprises et les indépendants dont le chiffre d’affaires ou les recettes n’excèdent pas 5 000 euros sont exonérés de la CFE. Les entreprises nouvellement créées ne sont pas non plus soumises à la CFE la première année de leur existence. D’autre part, le Code général des impôts précise que certaines activités sont également exonérées de la CFE. Il s’agit principalement d’organismes publics comme les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes de l'État pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, les grands ports maritimes, les ports autonomes, à l'exception des ports de plaisance, les exploitants agricoles, et d’autres activités listées dans les articles 1449 à 1466 F (exonérations et abattements de la CFE).
Comment est calculée la CFE ?
Contrairement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui est l’autre composante de la contribution économique territoriale (CET) avec la CFE, et dont le calcul est basé sur le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée produite par une entreprise, une partie de la CFE est calculée en fonction de la valeur locative des biens soumis à la taxe foncière dont les professionnels ont disposé pour les besoins de leur activité au cours de l'année N-2, c’est-à-dire des locaux à usage professionnel ou commercial. Cette base d’imposition est fixée par chaque commune.
Pour les entreprises et indépendants qui n’occupent pas de locaux ou dont la valeur locative est très faible, le montant de la CFE due est alors fixé par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui collectent cette taxe sur la base d'une cotisation forfaitaire minimum en fonction du chiffre d'affaires ou des recettes réalisées au cours de l’année N-2. Dans ce cas, la CFE est revalorisée chaque année. Par exemple, une entreprise dont le chiffre d’affaires est de moins de 10 000 euros paiera une CFE de base minimum comprise entre 221 et 526 euros. Pour un chiffre d’affaires ou des recettes de plus de 500 000 euros, la CFE sera au moins comprise entre 221 et 6 833 euros.
L’autre partie de la CFE est constituée d’une taxe assise sur la base d'imposition à la CFE dont le taux est voté chaque année par chaque Chambre de commerce et d'industrie de la région.
La base d’imposition utilisée pour le calcul de la CFE est réduite dans plusieurs cas : de 30 % pour les bases foncières des établissements industriels ; de 50 % pour les nouvelles activités professionnelles l'année qui suit leur création ; en proportion du temps d'inactivité pour certaines activités saisonnières comme celles des restaurants ou des cafés par exemple ; de 75 % pour un artisan qui emploie un salarié, de 50 % pour deux salariés et 25 % pour trois salariés si les bénéfices, les salaires versés, les cotisations sociales représentent plus de 50 % du chiffre d'affaires TTC ; 25 % pour les entreprises et indépendants implantés en Corse.
La déclaration et le paiement de la CFE
Toute entreprise ou indépendant doit effectuer une déclaration initiale de cotisation foncière des entreprises avant le 1er janvier de l'année suivant la création de leur activité à l’aide d’un formulaire disponible sur le site impots.gouv.fr. Cette démarche permet de déclarer les éléments d’imposition qui servent à établir le montant de la CFE.
Ensuite, il n’est pas nécessaire de recommencer cette démarche tous les ans sauf en cas de modifications (changement de la surface des locaux, cessation de l’activité, etc.) qu’il faut déclarer à l’aide du formulaire n°1447-M-SD.
Le paiement de la CFE, qui est dématérialisé, doit intervenir au plus tard le 15 décembre de chaque année. Si son montant est supérieur à 3 000 euros, le paiement se déroule en deux fois (avant le 15 juin et au plus tard le 15 décembre). Il peut se faire en ligne via un espace professionnel sur impots.gouv.fr. Le prélèvement de la CFE peut également être mensuel.
Dossiers similaires
-
Expert comptable en ligne : avantages, inconvénients, prix L’expert comptable est un professionnel clé pour une entreprise. S’il se charge de la gestion et du suivi de sa comptabilité, il intervient également dans un plus vaste champ de domaines et il...
-
Qu'est-ce qu'un plan comptable ? Un plan comptable ou un plan comptable général (PCG) est une référence en matière de comptabilité pour les entreprises. Ce livret composé de multiples éléments ressemble les normes, les lois...
-
Comment établir un devis en bonne et due forme ? Quelles sont les mentions obligatoires ? Avant la vente d’un produit ou d’une prestation de service, en particulier s’il s’agit d’opérations complexes et personnalisées pour un client, une entreprise a tout intérêt à...
-
Qu'est-ce que la réserve légale d'une entreprise ? Lorsqu’une entreprise réalise l’affectation de son résultat chaque année, elle doit doter une partie des bénéfices réalisés en réserve légale. En effet, en cas de résultat...
-
Le front-office d'une entreprise : qu'est-ce que c'est ? Quelle définition ? On entend souvent parler de back-office, sans doute un peu moins de front-office. Back et front sont deux contraires en anglais. Dans le monde professionnel, certains termes qui paraissent simples...
-
Comment choisir son comptable ou expert-comptable ? Toutes les entreprises sont contraintes par la loi de tenir une comptabilité que leur activité soit commerciale, artisanale ou libérale et qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle (sauf...
-
Comment calculer la TVA, quels sont les taux en vigueur ? La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt indirect collecté par les entreprises qui réalisent des opérations commerciales payantes. Cet impôt est entièrement supporté par le...
-
6 règles d'or qu'un service client ne devrait jamais oublier ! Pour une entreprise, un service client est un pan très important de son activité, et en particulier de sa communication. C'est en effet ce service qui est chargé des contacts et du suivi de ses...
-
Quels recours possibles pour une entreprise en difficulté ? Selon les années, jusqu'à 4 000 entreprises déposent leur bilan en France. Des entreprises en difficulté qui ne disposent plus de liquidités pour faire face à leurs dettes et pour continuer...
-
Coût de revient : comment le calculer ? Pour une entreprise, qu’elle soit commerciale, industrielle, artisanale ou de services, le calcul du coût de revient est une étape indispensable pour assurer une bonne gestion et la pérennité...
-
Les actifs d'une entreprise : qu'est-ce que c'est ? Savez-vous vraiment ce que sont les actifs d'une entreprise et comment on les classe ? En outre, savez-vous quels sont les indicateurs ou les critères permettant de déterminer la valeur qu'ils...
-
Le régime de retraite des indépendants : le dossier complet Le régime social des indépendants tend de plus en plus à se rapprocher de celui des salariés depuis les modifications apportées récemment à leur propre régime, la Sécurité sociale pour les...