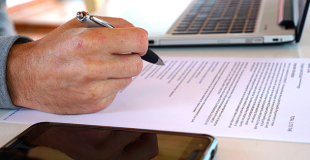Statut de conjoint collaborateur : définition et avantages

Le conjoint d'un dirigeant d'une d'entreprise qui intervient régulièrement dans la gestion, le fonctionnement et l'activité de cette dernière sans percevoir de rémunération peut obtenir le statut de conjoint collaborateur. Ce statut, toutefois limité à une durée de 5 ans maximum, permet à un conjoint collaborateur de bénéficier notamment d'une couverture sociale complète en matière d'assurance vieillesse et de percevoir des indemnités journalières en cas d'arrêt pour maladie. Ce statut est limité dans son application à certaines situations et demande de remplir des conditions bien précises. Tout savoir sur les modalités et les avantages du statut de conjoint collaborateur.
Conjoint collaborateur : quel est ce statut ?
Conjoint collaborateur est l'un des statuts, avec ceux de conjoint associé et de conjoint salarié, qu'une personne qui vit avec un chef d'entreprise peut prendre.
Pour être considéré comme conjoint collaborateur, plusieurs conditions doivent être remplies en même temps :
- être marié, pacsé ou vivre en union libre (une nouveauté pour les concubins depuis le 1er janvier 2022) avec un chef d'entreprise ;
- travailler activement et de manière régulière dans son entreprise (qui peut avoir une activité commerçante, artisanale, libérale ou agricole), c'est-à-dire justifier d'une participation directe, effective et habituelle à titre professionnel telle que la réalisation d'actes de gestion et d’administration nécessaires au fonctionnement de l’entreprise. Cette participation active n'a toutefois rien à voir avec le nombre d’heures quotidiennes ou mensuelles travaillées dans l’entreprise ;
- ne pas recevoir de rémunération ;
- et ne pas avoir le statut d'associé s'il s'agit d'une entreprise dont la forme juridique est une société.
Le statut de conjoint collaborateur est possible pour toute personne de nationalité française, ou d'un autre pays de l'Union européenne, à partir du moment où elle travaille pour l'entreprise de son conjoint en France. Ce statut peut être cumulé avec une activité salariée exercée parallèlement.
Le conjoint collaborateur ne perçoit pas de rémunération, n’a pas de contrat de travail et il peut conserver ce statut pendant une durée totale maximum de 5 ans.
D'autre part, devenir conjoint collaborateur est possible si son conjoint chef d'entreprise est un entrepreneur individuel, soit une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes, un micro-entrepreneur, un gérant associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), ou un gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée (SARL) ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL).
Concrètement, un conjoint collaborateur peut être détenteur d'un mandat pour accomplir au nom de son conjoint chef d'entreprise les actes de gestion courante de sa société.
En revanche, un conjoint collaborateur ne peut pas voir sa responsabilité financière engagée.
La couverture sociale du conjoint collaborateur
Le principal avantage du statut de conjoint collaborateur réside dans le fait qu'il permet de bénéficier d'une couverture sociale complète.
Le conjoint collaborateur est en effet notamment affilié obligatoirement au régime général de la Sécurité sociale en tant que travailleur indépendant, ou comme exploitant agricole à la Mutualité sociale agricole, soit la MSA, pour les conjoints collaborateurs d'un chef d'entreprise d'une exploitation agricole.
En effet, grâce à son statut, le conjoint collaborateur verse des cotisations à l'Urssaf qui lui donnent des droits propres.
Les cotisations versées à l'Urssaf par un conjoint collaborateur lui donnent en effet la possibilité d'acquérir des droits dans différents domaines :
- en matière de retraite de base et complémentaire ;
- en ce qui concerne l'assurance invalidité-décès ;
- en cas d'arrêt de travail, et après avoir cotisé pendant 1 an, le conjoint collaborateur peut être indemnisé sous la forme d'indemnités journalières ;
- de bénéficier d'allocations en cas de maternité ou paternité après 10 mois d'affiliation ;
- en matière de formation professionnelle continue.
En tant que conjoint collaborateur, l'époux, le concubin ou le partenaire de Pacs qui travaille régulièrement et sans être rémunéré pour l'entreprise de son conjoint peut également souscrire une assurance volontaire accidents du travail/maladies professionnelles auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).
À noter : le conjoint collaborateur n'a cependant pas le droit à l'assurance chômage.
Les cotisations versées à l'Urssaf par un conjoint collaborateur répondent à différents critères et aux choix de ce dernier.
En matière de retraite et d'invalidité/décès, le conjoint collaborateur peut choisir entre 5 solutions différentes :
- opter pour le partage des revenus à hauteur d’un tiers du revenu de son conjoint chef d’entreprise. Ses cotisations invalidité/décès sont calculées sur la base d’un tiers des revenus de son conjoint chef d’entreprise, qui cotise lui sur la base des deux tiers de ses revenus ;
- opter pour le partage des revenus à hauteur de la moitié du revenu de son conjoint chef d’entreprise ;
- choisir l'option sans partage des revenus, sur la base d’un tiers du revenu de son conjoint chef d’entreprise. Les cotisations invalidité/décès payées par le conjoint collaborateur sont alors calculées sur la base d’un tiers des revenus du conjoint chef d’entreprise, qui cotise lui sur 100 % de ses revenus ;
- choisir l'option sans partage des revenus sur la base de la moitié des revenus de son conjoint chef d’entreprise. Les cotisations sont donc calculées sur la base de la moitié des revenus de son conjoint chef d’entreprise, qui cotise lui sur 100 % de ses revenus ;
- ou choisir l'option sans partage des revenus sur une base forfaitaire. Ses cotisations sont calculées sur la base d’un tiers du plafond annuel de la Sécurité sociale. De son côté, le conjoint chef d’entreprise continue à cotiser sur la base de 100 % de ses revenus.
Pour pouvoir percevoir des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, le conjoint collaborateur doit verser une cotisation forfaitaire de 140 euros ou de 88 euros en cas de faibles revenus.
Une cotisation forfaitaire est aussi appliquée en ce qui concerne la formation professionnelle continue, mais cette dernière est payée par le conjoint chef d'entreprise, et elle est déductible de son compte de résultat.
D'autre part, un conjoint collaborateur n'a rien à verser au titre de l'assurance maladie-maternité, des allocations familiales, de la Contribution sociale généralisée (CSG) et de la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Les cotisations sociales versées par le conjoint collaborateur sont déductibles du revenu imposable de son foyer fiscal comme celles du conjoint chef d’entreprise sauf si ce dernier est soumis au régime fiscal de la micro-entreprise.
En résumé, le statut de conjoint collaborateur présente des avantages en matière de couverture sociale sans présenter un coût important pour une entreprise.
Comment déclarer le statut de conjoint collaborateur ?
Quand toutes les conditions sont réunies pour prétendre à prendre le statut de conjoint collaborateur, la demande pour bénéficier de ce statut doit être faite par le conjoint chef d'entreprise concerné.
Une démarche possible au moment de la déclaration de création de son activité, soit l'immatriculation de son entreprise, sur le site Internet du Guichet des formalités des entreprises, qui a remplacé depuis le 1er janvier 2023 le Centre de formalités des entreprises (CFE), ou à tout moment de la vie de l'entreprise.
La demande du statut de conjoint collaborateur doit obligatoirement être accompagnée d'une attestation sur l'honneur du conjoint concerné, signée de sa main, et qui confirme son choix de bénéficier de ce statut.
Cette attestation doit mentionner les informations suivantes :
- les nom et prénom du conjoint qui souhaite obtenir le statut de conjoint collaborateur ;
- son numéro de Sécurité sociale ;
- la nature de son lien juridique avec le chef d'entreprise ;
- les nom et prénoms du conjoint chef d'entreprise ou, s'il s'agit d'une société, sa dénomination ou raison sociale, son numéro unique d'identification et l'adresse de son siège social ;
- le statut par rapport au chef d'entreprise, en l'occurrence ici celui de conjoint collaborateur ;
- la date de départ du statut de conjoint collaborateur ;
- justifier de la participation régulière à l'activité professionnelle de son conjoint en tant que non salarié.
Suite à cette démarche, et si toutes les conditions sont remplies, le conjoint collaborateur est inscrit sur le Registre national des entreprises (RNE) et sur le Registre du commerce et des sociétés (RCS).
Comment mettre fin au statut de conjoint collaborateur ?
Le statut de conjoint collaborateur prend fin automatiquement dans 3 situations : au bout de 5 ans, à la demande du conjoint chef d'entreprise, ou si un événement intervient entre les conjoints ou dans la vie de l'entreprise.
La fin automatique du statut de conjoint collaborateur au bout de 5 ans
Le statut de conjoint collaborateur a une durée limitée de 5 ans depuis la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022.
À l'issue de ce délai de 5 ans, le conjoint chef d'entreprise doit lui donner un statut plus protecteur que celui de conjoint collaborateur, soit celui d'associé, qui lui donne notamment le droit de détenir des part sociales dans la société et donc un droit de vote aux assemblées générales, soit celui de conjoint salarié qui implique de faire signer un contrat de travail à ce dernier et de lui verser un salaire supérieur ou égal à 1 747,20 euros brut par mois.
Le passage au statut de conjoint salarié est systématique au bout de 5 ans si aucune déclaration de changement de statut n'est faite de la part du conjoint chef d'entreprise.
À noter : les conjoints nés en 1964 ou avant et qui ont obtenu le statut de conjoint collaborateur avant 2022 peuvent conserver cette position jusqu'à leurs 67 ans maximum. Ceux qui ont acquis ce statut entre 2017 et 2022 peuvent rester conjoints collaborateurs au maximum jusqu'en 2026.
À la demande du conjoint chef d'entreprise
Le conjoint chef d'entreprise a la possibilité de mettre fin au statut de conjoint collaborateur dont bénéficie son époux, son partenaire de Pacs ou son concubin sur simple demande auprès du Guichet des formalités des entreprises par le biais d'une déclaration modificative.
En cas d'événements spécifiques
Le statut de conjoint collaborateur cesse automatiquement dans les cas suivants, qui représentent des événements particuliers :
- si les statuts de l'entreprise pour lequel le conjoint collaborateur travaille régulièrement changent ;
- en cas de décès du conjoint chef d'entreprise ;
- si le conjoint collaborateur divorce de son époux chef d'entreprise ;
- si le Pacs qui unit le conjoint collaborateur et le chef d'entreprise cesse.
Dossiers similaires
-
Quels types de documents d'entreprise peut-on faire signer électroniquement ? Pour les entreprises, comme pour les particuliers, de nombreux actes administratifs, juridiques, commerciaux, etc., sont aujourd’hui dématérialisés, c’est-à-dire qu’ils prennent la forme de...
-
La CIPAV pour les professions libérales : affiliation, cotisation, conseils La majorité des professions libérales dépendaient de la CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse) jusqu’à la fin de l’année 2018.Depuis, la loi de...
-
Qu'est-ce qu'un compte de résultat ? Comment l'analyser et le comprendre ? Le compte de résultat fait partie des éléments financiers indispensables qu’une entreprise doit produire au même titre que le bilan comptable. Le compte de résultat reflète les performances...
-
Facturation électronique pour toutes les entreprises : caractéristiques et conditions D'ici 2026, toutes les entreprises établies en France, et qui sont assujetties à la TVA, vont devoir émettre obligatoirement des factures au format électronique dans un souci de modernisation...
-
Comment savoir si un nouveau client professionnel est solvable ? Avant d'accepter une commande importante pour votre entreprise, vous devez vérifier la solvabilité de votre futur client. Cela est particulièrement vrai si c’est la première fois que vous...
-
Saisie conservatoire en cas de factures impayées : quel fonctionnement ? Lorsqu’un débiteur ne règle pas ses dettes, le créancier peut solliciter une saisie conservatoire. Ce dispositif consiste à mandater un huissier de justice pour dresser l’inventaire des biens...
-
Comment choisir votre prévoyance d’entreprise ? Vous souhaitez souscrire à une couverture supplémentaire pour vos salariés ? Découvrez les facteurs à considérer pour faire le bon choix. Qu'est-ce qu'une prévoyance d’entreprise, et...
-
Ebitda : définition et utilité. Comment le calculer ? L'Ebitda est un indicateur financier qui apparaît dans les documents liés au budget d'une entreprise et qui permet de savoir si cette dernière est rentable, c'est-à-dire estimer si son activité...
-
Céder son entreprise : auprès de qui prendre conseil ? Céder son entreprise, c’est un projet qui se prépare. En effet, une telle décision implique des conséquences professionnelles et personnelles qu’il est impératif de prendre en compte pour...
-
Gestion des stocks : pourquoi est-ce si important ? Comment les optimiser ? La gestion des stocks d’une entreprise à des incidences dans plusieurs domaines. D’abord, par rapport à sa clientèle. Ses stocks lui permettent en effet de répondre aux demandes de ses...
-
Qu’est-ce qu’une stratégie globale en entreprise ? Quel est le schéma que vous allez suivre en lançant votre entreprise ou bien en la développant ? Quels sont vos objectifs et surtout quels sont vos plans pour les atteindre ? C’est de cet...
-
Diagnostic d'entreprise : étapes et méthode pour le réaliser Aujourd'hui, l’heure est aux changements toujours plus rapides et la pression toujours plus grande. Les attentes sont toujours plus fortes. Les clients attendent des entreprises qu’elles aient...